Lettre d'information de la CNT en région parisienne
Abonnez-vous à la lettre d'information électronique mensuelle de la CNT en région parisienne pour être tenu au courant de nos activités.
Myrtille Gonzalbo, giménologue qui interviendra lors de notre 4e journée de commémoration critique du centenaire, a accepté de répondre à quelques questions préalables sur la Révolution russe et ses mythes. Nous l’en remercions.
Au delà de cette interview, nous invitons celles et ceux que le sujet intéresse à se plonger dans son ouvrage de référence :
- Les chemins du communisme libertaire en Espagne 1868-1937 » (Editions Divergences, 2017)
A travers votre participation aux Giménologues et votre dernière publication vous revendiquez une démarche historique non académique. Pouvez-vous préciser la particularité de cette démarche ?
Les Giménologues sont un petit collectif d’amis devenus historiens amateurs en se dédiant depuis 2004-2005 à la publication des Souvenirs de la guerre d’Espagne d’Antoine Gimenez, alias de Bruno Salvadori, un milicien volontaire du Groupe International de la colonne Durruti, mort à Marseille en 1982.
On ne pensait pas se trouver encore sur le coup douze ans après. Nous avons d’abord réalisé un feuilleton radiophonique de dix heures avec des amis de Radio Zinzine à Forcalquier, et c’est en rédigeant les mises en contexte du récit que nous avons pris la mesure de la richesse historique de ce document. Cela nous a entraînés dans un passionnant cycle de recherches et de trouvailles dont nous ne sommes toujours pas sortis. Au vu de la taille finale de notre appareil critique, nous nous sommes bombardés « spécialistes » des écrits de Gimenez [1].
Depuis 2006, au cours de multiples tournées de présentations, nous avons fait des rencontres inattendues avec des anarchistes espagnols de plus de 85 ans, devenus des amis. La plupart étaient des anciens miliciens du front aragonais, qui avaient lu de près le récit d’Antoine. C’est ainsi qu’est né en 2016 le second ouvrage "A Zaragoza o al charco ! Aragon 1936-1938. Récits de protagonistes libertaires" (paru chez L’Insomniaque, voir en ligne), nourri de leurs histoires directement racontées (ou via leurs enfants).
La « giménologie » renvoie aussi à la méthode adoptée : nous attribuons une grande valeur historique aux écrits et aux témoignages des protagonistes [2] du processus révolutionnaire engagé dans ce pays depuis le milieu du XIXe siècle. Chaque parcours individuel est fort en soi et rappelle que les hommes et les femmes de cette époque étaient chargés d’un intense désir d’émancipation collective. Nous y voyons une illustration de la dynamique individu-collectif où le premier ne se dilue pas dans le second, propre au mouvement libertaire. Ensuite, autant que possible, nous confrontons les témoignages à d’autres sources (archives, presse), sans cesse alimentées par des personnes qui nous écrivent, et par l’amical réseau de mise en commun des données qui traverse, entre autres, le milieu libertaire ; sans oublier les riches centres de documentation de Lausanne et Marseille (CIRA).
Ainsi continuons-nous à puiser dans l’abondant matériau à notre disposition pour comprendre comment le mouvement communiste libertaire espagnol a pu focaliser en lui un tel espoir de révolution sociale dans les années trente.
Les traducteurs anonymes des Motions du congrès de Saragosse, qui contient la motion-programme sur le communisme libertaire adoptée en mai 1936, concluaient ainsi leur préface (rédigée à la fin des années 1970) : "La CNT a […] rencontré à la mort de Franco une situation historique qui ne se reproduira plus : la possibilité de constituer une des premières organisations quantitatives de la nouvelle époque. Tout ce que la jeunesse comptait de révolte semblait se retrouver en elle, comme chez elle. […] Mais il aurait fallu […] entreprendre la critique de l’histoire de [la] défaite, [et] que [la CNT] s’attaque au centre moderne de l’idéologie : le travail. Il lui aurait fallu associer à toute revendication ayant le travail pour objet l’impérieuse nécessité de sa suppression. Il lui aurait fallu s’ouvrir à la critique du syndicalisme et de la vie quotidienne."
Décidés à participer à cette « critique de l’histoire de la défaite », il nous a fallu dépoussiérer une partie de l’historiographie anarchiste qui a trop cédé à la mythification, forcément réductionniste, tout en masquant bien des aspects du processus révolutionnaire.
Nous avons beaucoup appris sur le mouvement anarchiste espagnol depuis l’intérieur, sur sa richesse, ses audaces comme sur ses autolimitations. Et nous pensons qu’il y a toujours des enseignements à tirer pour aujourd’hui de la inédite tentative collective de sortie du capitalisme qui fut à l’œuvre en 1936-1937.
Nous sommes plutôt encouragés à continuer du fait que les souvenirs d’Antoine, ceux des autres protagonistes ainsi que le matériel documentaire présenté depuis douze ans reçoivent un très bon accueil lors des débats publics, notamment dans les lieux comme Notre-Dame-des-Landes. Et de manière générale là où des gens s’émancipent de la passivité ambiante, en ville comme en milieu rural, et s’engagent dans une démarche de rupture où mille activités se déploient dans un rapport au temps qui échappe (en partie) à celui du salariat. Ils s’intéressent particulièrement au contenu du projet communisme libertaire, aux pratiques sociales qui se mirent en place en Aragon, à la critique du salariat et du travail. Certains nous ont dit être heureux de pouvoir raccorder leur expérience à ce qui a été tenté par les anars des quartiers de Barcelone et des communes aragonaises.

Dans votre dernier ouvrage vous dissociez divers courants de l’anarchisme espagnol. Doit-on-y voir la différentiation entre syndicalisme et anarchisme que faisait Malatesta ?
"Qui dépend d’un salaire, quelle que soit sa forme, ne peut se considérer comme un homme libre. […] Ni gouvernement, ni salaire ! […] Il ne s’agit déjà plus de travailler plus ou moins d’heures, et encore moins de recourir à des manifestations pompeuses et rachitiques, mais d’une lutte sans merci où la classe ouvrière a jusqu’à aujourd’hui porté la charge la plus lourde. Maintenant qu’elle est engagée, on ne peut échapper à ce dilemme : ou nous nous résignons, et nous succombons à la servitude volontaire, ou nous nous rebellons un bon coup contre tant d’outrages, d’injustices et d’ignominies, afin de montrer aux exploiteurs et aux gouvernants que nous ne sommes pas un troupeau de moutons prêts à être tondus." (Extrait d’un folleto anarcho-communiste diffusé à Barcelone, le premier mai 1892.)
Dans les années 1868-1872, les idées et pratiques anarchistes en cours d’élaboration dans le creuset de l’AIT, puis de l’Internationale anti-autoritaire collectiviste, se combinèrent magistralement avec le fond anti-étatiste, anticlérical et anticapitaliste d’une partie des classes populaires espagnoles. Cette rencontre commença très fort, car dès 1872 l’AIT anti-autoritaire recommanda sa section espagnole, la FRE, « comme la meilleure jusqu’à ce jour » ; c’était aussi celle qui avait le plus grand nombre d’affiliés, et qui allait durer le plus longtemps. À partir de là, notamment en Catalogne, en Andalousie et dans le Levant, se cherchèrent, se trouvèrent et parfois se complétèrent des façons de résister au processus capitaliste de réduction des hommes à leur force de travail. Elles furent à l’œuvre non seulement dans les sociétés ouvrières de résistance des ateliers, usines et communes rurales, mais aussi dans les quartiers populaires, notamment à partir de pratiques associationnistes ancrées dans les principes de respect de l’individu, de liberté, de solidarité, d’auto-éducation, de rapport à la nature et à la culture, dans des espaces – écoles rationalistes, ateneos etc. – qui se tenaient à l’écart des institutions bourgeoises et religieuses.
Mais quand il s’est agi de concevoir la société à venir, les modalités du projet communiste libertaire [3] donnèrent lieu les années suivantes à des polémiques très dures en Espagne entre les collectivistes anarchistes, restés attachés aux Idées sur l’organisation sociale de James Guillaume (1876), et les communistes anarchistes (les premiers communistes libertaires), inspirés par les thèses de Kropotkine rassemblées en 1892 dans "La Conquête du pain".
Si les uns et les autres s’accordaient sur la socialisation des moyens de production à opérer dès le premier jour de la révolution, ils divergeaient sur les conditions de la redistribution des biens produits. Pour les collectivistes, l’ouvrier devait recevoir le « produit intégral de son travail » et l’échanger contre son équivalent en biens de consommation. Les communistes anarchistes estimaient qu’en deçà de la mise en commun totale et immédiate des produits du travail entre tous les hommes, et de la suppression du salariat et de la propriété privée, sous toutes leurs formes, on prenait le risque de retomber dans les rapports sociaux capitalistes.
En rapport avec ces divergences, toujours au sein de la FRE et de ses organisations de type présyndical – Sections de métiers et Sociétés de résistance – des différences de conceptions apparurent sur la façon de mener le combat. Les ouvriers très qualifiés de l’industrie catalane, qui empoignaient volontiers l’arme de la grève, ne se sentaient pas toujours en phase avec les journaliers sans terre d’Andalousie, qui recouraient le plus souvent au sabotage des biens des propriétaires, et multipliaient les mouvements insurrectionnels. Quant aux petits groupes nés dans la clandestinité, ils ne voulurent pas se dissoudre au moment d’en sortir en 1881, et ils soutinrent particulièrement les activistes andalous sur lesquels la répression s’acharnait, et que la FRE devenue plus « légaliste » abandonnait à leur sort. Ainsi se développèrent les groupes d’affinité anarchistes, très fluctuants et rétifs à tout encadrement, adeptes de la propagande par le fait. Les plus fameux se répandirent en Catalogne, en liaison avec des réseaux internationaux. Ils critiquèrent violemment la FRE et, en dissidence avec elle, ils commencèrent à diffuser les idées communistes anarchistes, axées sur l’abolition du salariat et de la valeur d’échange.
Ces divergences, tant sur le plan des idées que sur celui des pratiques, qui continuèrent à s’exprimer dans des années 1890, s’inscrirent durablement dans le mouvement libertaire espagnol. Mais elles ne sont pas réductibles – comme on l’a souvent avancé – à une confrontation entre l’option légaliste et l’option illégaliste, couplée ou non au recours à la violence. On ne peut pas non plus en faire le tour en opposant les individualistes aux collectivistes, ou les luttes en milieu urbain à celles en milieu rural, ou encore les résistances menées depuis les lieux de travail (usines, ateliers) à celles qui surgissaient depuis les lieux d’existence (rue, quartier, commune). On peut par contre invoquer une polarité qui émergea et s’installa durablement entre le « possibilisme » anarchiste et l’« intransigeance » révolutionnaire.
De fait la différentiation entre syndicalisme et anarchisme que faisait Malatesta (l’un des premiers communistes anarchistes avec Cafiero) s’ancrait pour une part dans les points forts de ces deux tendances. Mais si l’on se réfère à la position de Malatesta exprimée lors du Congrès international anarchiste d’Amsterdam (1907), on constate qu’il encouragea les anarchistes à s’activer dans les syndicats, tout en restant « purs », sans y prendre de responsabilités, sans devenir des permanents, et uniquement pour y radicaliser les actions et recruter. Ce qui impliquait une « gymnastique révolutionnaire » un peu alambiquée.

Lors de ce Congrès, on croisa essentiellement le fer sur la valeur révolutionnaire du syndicalisme, ses limites, et la meilleure tactique à observer pour les anarchistes. Le représentant de la CGT, Pierre Monatte, se fit le porte-parole de la doctrine syndicaliste révolutionnaire, rappelant qu’elle renouait avec l’aile anti-autoritaire de la première Internationale. Tout en insistant sur ce que le syndicalisme avait de commun avec l’anarchisme – le fédéralisme, l’autonomie, l’action directe, l’antiparlementarisme, le projet révolutionnaire – il concluait que la CGT n’était pas anarchiste et devait rester neutre politiquement : « La classe ouvrière, devenue majeure, entend se suffire à elle-même. » Avec le principe du syndicat unique (un seul syndicat par profession et par ville), la lutte des classes ne serait plus entravée « par les chamailleries des écoles ou des sectes rivales. » Il invitait les anarchistes à abandonner la tour d’ivoire de la spéculation philosophique » pour se fondre dans le mouvement syndical.
Son contradicteur, Errico Malatesta, contesta les vertus révolutionnaires du syndicalisme en ces termes : « Le mouvement ouvrier n’est pour moi qu’un moyen […]. Ce moyen, je me refuse à le prendre pour un but. […] Les syndicalistes, à rebours, tendent à faire du moyen une fin, à prendre la partie pour le tout. Et c’est ainsi que dans l’esprit de certains de nos camarades, le syndicalisme est en train de devenir une doctrine nouvelle et de menacer l’anarchisme dans son existence même. […] Or, même s’il se corse de l’épithète bien inutile de révolutionnaire, le syndicalisme n’est et ne sera jamais qu’un mouvement légalitaire et conservateur. […] Je n’en chercherai d’autre preuve que celle qui nous est offerte par les grandes unions nord-américaines […]. Après s’être montrées d’un révolutionnarisme radical, aux temps où elles étaient encore faibles, ces unions sont devenues […] beaucoup moins hostiles au capitalisme patronal qu’aux ouvriers non organisés. […] L’erreur fondamentale de Monatte et de tous les syndicalistes révolutionnaires provient, selon moi, d’une conception beaucoup trop simpliste de la lutte de classe. C’est la conception selon laquelle les intérêts économiques de tous les ouvriers – de la classe ouvrière – seraient solidaires […]. [Or] au sein de la « classe » ouvrière elle-même existent, comme chez les bourgeois, la compétition et la lutte. […] Cependant, parmi les prolétaires, la solidarité morale est possible, à défaut de la solidarité économique. […] C’est le rôle des anarchistes d’éveiller les syndicats à l’idéal, en les orientant peu à peu vers la révolution sociale – au risque de nuire à ces « avantages immédiats » dont nous les voyons aujourd’hui si friands. […] La grève générale m’a toujours paru un moyen excellent pour ouvrir la révolution sociale. Toutefois gardons-nous bien de tomber dans l’illusion néfaste qu’avec la grève générale, l’insurrection armée deviendrait une superfétation. […] Préparons-nous donc à cette insurrection inévitable, au lieu de nous borner à préconiser la grève générale, comme une panacée. […] Il faudra s’emparer par la force des moyens d’approvisionnement, et cela tout de suite, sans attendre que la grève se soit développée en insurrection. […] La révolution anarchiste que nous voulons dépasse de beaucoup les intérêts d’une classe : elle se propose la libération complète de l’humanité actuellement asservie, au triple point de vue économique, politique et moral. Gardons-nous donc de tout moyen unilatéral et simpliste. » (Collectif, 1997, pp. 195-199)

L’exemple de la FORA [Fédération ouvrière de la Région argentine] venait contredire concrètement la théorie de la neutralité syndicale avancée par Monatte, et aussi par Malatesta à sa façon. Elle se définissait comme une organisation de résistance ouvrière plutôt que comme un syndicat. Elle refusait le postulat suivant lequel ce dernier formerait l’embryon de la société future, car l’idée de remplacer le pouvoir de l’État par celui du syndicat allait à l’encontre de ses principes anti-autoritaires. Le syndicalisme étant considéré comme le produit du dispositif capitaliste, il devait disparaître avec lui [4]. Les militants de la FORA étaient partisans de la libre association des producteurs et de la libre fédération des associations de producteurs et de consommateurs, car son action ne se limitait pas au monde du travail – en 1907 elle fut à l’origine d’une importante grève des loyers. Tout ceci contenait en germe les éléments de « l’anarcho-syndicalisme », concept dont l’existence est attestée en Angleterre et en Russie en 1904 et 1905.
Dans tous les cas, il se dégage des successives motions adoptées à Amsterdam que les syndicats furent considérés « à la fois comme des organisations de combat dans la lutte de classe en vue de l’amélioration des conditions de travail, et comme des unions de producteurs pouvant servir à la transformation de la société capitaliste en une société communiste anarchiste » (Ibid., p. 205). Les anarchistes avaient pour tâche de constituer dans ces organisations l’élément révolutionnaire :
« Le congrès Communiste libertaire […] reconnaît dans la grève générale économique révolutionnaire, c’est-à-dire dans le refus de travail de tout le prolétariat comme classe, le moyen apte à désorganiser la structure économique de la société actuelle, et à émanciper le prolétariat de l’oppression du salariat. […] Pour la réalisation de cette grève générale, la pénétration des syndicats par l’idéal anarchique doit être considérée comme indispensable. » (Motion sur le syndicalisme, Ibid., p. 207).
Si les congressistes ne revinrent pas sur la série d’attentats individuels réalisés par des anarchistes dans les années précédentes, ils ne les condamnèrent pas non plus. Emma Goldman fit même voter une déclaration « en faveur du droit de révolte de la part de l’individu comme de la part de la masse entière ». Et l’on sent la patte de cette dernière dans ce passage de la motion sur le principe de l’organisation qui fut adoptée par le Congrès : « Le principe même de l’anarchie réside dans la libre organisation des producteurs. […] L’action individuelle, pour importante qu’elle soit, ne saurait suppléer au défaut d’action collective, de mouvement concerté ; pas plus que l’action collective ne saurait suppléer au défaut d’initiative individuelle. […] La Fédération anarchiste est une association de groupes et d’individus où personne ne peut imposer sa volonté […]. Elle a pour but de changer toutes les conditions morales et économiques, et en ce sens, elle soutient la lutte par tous les moyens adéquats. » (Ibid., pp. 172 et 210)
Mais indéniablement, l’entrée des anarchistes dans les syndicats marqua un tournant décisif vis-à-vis des « En-dehors », les éléments révolutionnaires individualistes, tout particulièrement en France.
C’est dans ce contexte que le syndicalisme révolutionnaire « à la française » arriva en Espagne, « parrainé » en quelque sorte par les votes des congressistes d’Amsterdam. Peu après se créait à Barcelone « Solidarida Obrera », creuset de la future CNT [5].
Dès l’origine du mouvement anarchiste espagnol, vous révélez que les antagonismes se créent autour de la valeur travail. Ces divergences sont-elles pour vous à l’origine de l’échec révolutionnaire de 1936 ?
La polémique des années 1880-1890 entre collectivistes et communistes anarchistes au sein de la FRE portait plus précisément sur le maintien ou non du salariat et de la valeur d’échange dans la société post-capitaliste, et sur le rôle attribué à la commune dans la société post-capitaliste. C’est à ce moment-là qu’émergèrent les différences de conceptions aussi bien sur la façon d’organiser le combat contre le capitalisme et l’État, que sur la construction de la société à venir.
On en retrouve la trame dans les tensions entre les deux courants qui, au sein de la CNT des années trente, vont aborder le projet communiste libertaire de façon différenciée : le courant communaliste et le courant syndicaliste.
- Le courant communaliste : Le communalisme, système fédéraliste basé sur la commune rurale autonome, s’était parfaitement combiné avec le vieil idéal de la vie au pueblo. La vision du monde des communalistes s’inscrivait à la fois contre les mœurs des vieilles classes possédantes et contre celles des bourgeois. Elle fondait les relations sociales sur une éthique anarchiste personnelle et sur le rétablissement des valeurs morales liées au fait de vivre de la terre. Dans ce cadre le travail en commun pour satisfaire immédiatement les besoins sans passer par le salariat était fondamental. Le syndicat devait avoir une fonction limitée et disparaître avec le capitalisme : « Quand nous aurons gagné, le syndicalisme aura terminé sa mission puisque disparaîtra le régime du salariat qui lui a donné vie. […] Il faut qu’il n’y ait plus de corps de bureaucrates, et le syndicalisme […] avec ses grandes organisations et ses grands centres de production et de consommation rend nécessaire un grand réseau de fonctionnaires [6]. »
Le communaliste Santillán raillait en 1925 les « théoriciens de ce syndicalisme basé sur la conception matérialiste de l’histoire qui court derrière le capitalisme en copiant ses modalités et en intégrant les “moyens” qu’il se crée au fil de son développement industriel ».
En 1931 il fustigeait en ces termes le taylorisme et la domination du procès de production s’exerçant sur le travailleur : « Le germe du fascisme […] réside dans tout ce qui demande à l’homme de cesser de l’être pour vouer un culte à des réalités ou à des abstractions prétendument supérieures. […] L’industrialisme moderne à la façon de Ford est du pur fascisme, un despotisme légitimé. Dans les grandes usines rationalisées, l’individu n’est rien, la machine est tout. Ceux d’entre nous qui aimons la liberté ne sommes pas seulement ennemis du fascisme étatique, mais également du fascisme économique. »
Les communalistes suivaient Gustav Landauer pour qui le prolétariat ne pouvait venir à bout du capitalisme et de l’État qu’en s’abolissant lui-même comme classe, et « en entrant dans d’autres relations » : « Le capitalisme n’est pas une période de progrès mais de déclin. Le socialisme ne viendra pas sur la voie d’un développement ultérieur du capitalisme, et il ne viendra pas du fait de la lutte des travailleurs, en tant que producteurs, à l’intérieur du capitalisme. [Toutes les luttes syndicales] sont nécessaires à l’intérieur du capitalisme, tant que les travailleurs ne savent pas en sortir. Mais cela tourne toujours de manière forcenée dans le circuit fermé du capitalisme ; ce qui se passe au sein de la production capitaliste ne peut mener qu’à une intégration toujours plus marquée en elle. » (Landauer 1911-1919, Incitation au socialisme)
Les communalistes espagnols cultivaient un « progressisme » proposant de réconcilier ville et campagne, de décongestionner les cités et les industries en créant des agrociudades. Avec des variantes selon les auteurs le progrès scientifique, technique et industriel devait être contenu et orienté en vue de satisfaire les besoins des hommes ayant aboli le salariat, et ne souhaitant pas passer leur temps au labeur. Presque tous les textes communalistes évoquaient l’idéal de vie qui consiste à travailler moins et de façon plus agréable et surtout pas dans l’industrie : dans un article de 1929 intitulé « Abajo la racionalizacion ! » il est avancé que « L’homme doit œuvrer librement et placer toute son intelligence dans ce qu’il fait, sans devenir le maillon de la chaîne du travail où l’ouvrier ne peut arrêter son effort un seul instant ».
- Le courant anarcho-syndicaliste et syndicaliste « pur » : De 1919 à 1931 la CNT se concentra de plus en plus sur les luttes en milieu urbain. « De moyen de lutte et de résistance », le syndicat devint en 1931 une fin en soi, il devait être conservé après la chute du capitalisme pour structurer la nouvelle société (réduction du rôle de la commune). Le concept de communisme libertaire fut très discuté via revues et brochures en 1932-33 et le programme rédigé par d’Isaac Puente recueillit un immense succès auprès de la base (tirage à 100 000 exemplaires). Puente tenta de combiner les deux courants. Sa conception s’articulait sur trois piliers : l’individu, la commune et le syndicat. Le municipio était l’élément fondamental de l’organisation à la campagne, « où la réalisation du Communisme Libertaire est la plus simple à réaliser ». Il le considérait comme une « institution enracinée et très ancienne, qui doit récupérer son ancienne souveraineté ».
Quant aux ouvriers de l’industrie, ils se serviront du syndicat comme structure de base de la production, c’est « l’organisation vers laquelle vont spontanément les producteurs ». Les coopératives s’occuperont de la distribution par le biais d’un carnet de producteur ou de rationnement selon le principe : « À chacun selon ses besoins. » Cette formule de la « nouvelle justice distributive » ne se résoudra équitablement que par l’abondance obtenue, notamment, en rationnant ce qui est rare. On abolira l’argent en tant que signe de richesse cumulable, mais l’usage de bons de consommation restera provisoire : il faudra trouver une meilleure solution.
Sept points sont essentiels dans son programme : abolition de la propriété privée, de l’autorité, du salariat ; toute la souveraineté revient à l’assemblée ; le travail est obligatoire pour tous les membres, la distribution est organisée par la collectivité. Et enfin, les échanges de produits nécessaires entre localités se font sans équivalence de valeur, car ils sont tous équivalents en soi, quel que soit le travail qu’ils ont demandé, ou l’utilité qu’ils représentent. La notion de valeur est étrangère à l’économie libertaire, il n’y a donc aucune raison de la mesurer avec la monnaie.
Mais pour Michael Seidman, les idées communalistes étaient en train de devenir minoritaires au sein du mouvement libertaire dans les années trente : « À l’intérieur du mouvement ouvrier, les anarchistes qui pensaient que le syndicat devait devenir le fondement de la future société communiste libertaire gagnèrent du terrain par rapport à ceux qui tenaient une position plus individualiste, ou ceux qui considéraient que les fondations de la nouvelle société seraient les communes rurales. […] La position des anarcho-syndicalistes reflétait l’acceptation croissante de l’industrialisation parmi les militants libertaires. »
Et cette « acceptation croissante de l’industrialisation » impliquait de lier les ouvriers au tempo de la machinerie industrielle, comme le faisaient les socialistes et les marxistes, et de proposer comme eux « la construction d’une utopie sur le lieu de travail » qui passerait inéluctablement par la soumission ouvrière au travail, lequel serait « naturellement » chargé de sens.
Le passage d’une vision du communisme libertaire à une autre va s’incarner en la personne de Santillan. À partir de 1933-34, il va systématiquement déconstruire le projet communaliste qu’il avait défendu. Il commença par vanter les mérites de la modernisation de l’appareil de production : « L’industrie moderne est un mécanisme qui a son rythme propre. Le rythme humain ne détermine pas celui de la machine ; c’est celui de la machine qui détermine celui de l’homme. […] Si on part du lieu de travail, les communes autonomes sont superflues […]. Le localisme économique est passé et il doit passer, là où ce n’est pas encore fait, au musée des antiquités. L’organisation de l’usine, et non pas la commune libre […] ni le groupe d’affinité, doit être le noyau de la société anarchiste future. […] Si nous combattons la structure économique et sociale capitaliste c’est parce qu’en elle le travail, base de tout ce qui existe pour rendre l’existence de l’homme possible, ne reçoit pas la primauté à laquelle il a droit. » (juin 1936)
Le rôle du syndicat devint central dans le cadre de la nouvelle société industrielle qu’il appelait de ses vœux, et il en viendra à parler de « l’évidente nécessité d’une économie planifiée » qui gèrera production et redistribution. Il appela au réalisme les anarchistes « obnubilés par le Communisme Libertaire ». Il dénigra l’agrarisme, les groupes d’affinité, l’attachement à la commune, le fait de vivre de la terre de manière autarcique en pratiquant l’appui mutuel : « Il nous semble qu’il règne dans nos milieux libertaires un peu de confusion entre ce qui relève de la convivialité sociale, le regroupement par affinité et la fonction économique. Les vieilles visions […] sur les communes libres agissent sur la mentalité de certains camarades. […] L’avenir est complètement autre. À l’usine nous ne recherchons pas l’affinité comme dans le couple ou dans l’amitié […]. À l’usine, ce qui nous intéresse par-dessus tout, c’est notre collègue ouvrier qui connaît son boulot et l’exécute sans créer de difficultés inhérentes à l’inexpérience ou à l’ignorance du fonctionnement de l’ensemble. »
Tout en prétendant ne pas craindre « une résistance massive au travail », il appela les anarchistes à changer leur conception du sens de la vie, à éliminer une fois pour toutes « la tendance à vivre sans travailler présente tout au long de l’histoire espagnole [afin que] les loisirs, paresse et parasitisme dégradants [soient] éliminés. »
Et surtout, à l’instar des marxistes, Santillan dissocia le secteur de la production du système capitaliste : « La révolution doit mettre un terme à la propriété privée des usines, mais si l’usine doit continuer à exister et, selon moi, se perfectionner, alors il faut accepter les conditions de son fonctionnement. L’essence de la production et la méthode de production ne changent pas en devenant propriété sociale. C’est la distribution des produits qui change et qui devient désormais plus équitable. » (Extrait de « Sur l’anarchie et les conditions économiques », Tiempos Nuevos 1934).
Seidman pense que cette « volte-face abrupte de Santillan » et de bien d’autres de la CNT-FAI fut induite par la crise qui amena beaucoup de militants à penser que la chute du capitalisme était inéluctable, et qu’ils devaient être capables de gérer la transition économique vers le communisme libertaire. Ajoutons la fascination qu’exerça indéniablement sur eux machinerie industrielle.
Un partisan du « syndicalisme pur », Joan Peiró, déclarait pour sa part en 1931 : « À la concentration du capitalisme doit correspondre celle de la force du prolétariat ; le syndicalisme est “ industrialiste ” dans la mesure où il se voit obligé d’adapter ses comportements aux coordonnées technologiques et économiques du système auquel il veut succéder. »
Tandis que cet autre, Fornells, annonçait en mai 1933 au mouvement libertaire sa fin prochaine : « Le syndicalisme a fait une révision des valeurs de l’anarchisme (…) ; ce dernier doit convenir que l’homme de ses réalisations n’existe pas et que l’organisation de la société ne peut être celle qui fut conçue avant la révolution industrielle. »
Ce sont les représentants de cette tendance syndicaliste à outrance qui furent aux manettes après le 19 juillet 1936, et qui repoussèrent l’application du programme communiste libertaire aux calendes grecques. À partir de là, les syndicats CNT et UGT procédèrent ensemble, malgré les difficultés dues à la guerre et au-delà de leurs dissensions, à un début de rationalisation, de standardisation, de concentration et de modernisation de l’archaïque appareil industriel barcelonais. Et ils se battirent pour créer un marché national compétitif.
Doit-on s’étonner qu’un projet d’émancipation libertaire, vidé de son contenu révolutionnaire et désormais associé à la soumission volontaire au temps et à l’espace du travail industriel n’ait pas fait recette ?
Que pensez-vous de l’ouvrage de Michael Seidman : « Ouvriers contre le travail » ?
Nous y avons trouvé plusieurs angles de vue vis-à-vis du travail qui ont coïncidé avec nos propres recherches et analyses :
1) Seidman ne considère pas les ouvriers comme des « producteurs potentiellement parfaits », mais plutôt comme des « résistants qui doivent en permanence être mis au pas ou séduits pour accepter le travail ». Les refus du travail sont restés « une part intrinsèque de la culture ouvrière. » Il prend ses distances avec les historiens marxistes et les théoriciens de la modernisation qui les ignorent ou les sous-estiment. Ils se fondent, selon lui, sur une approche progressiste de l’histoire qui laisse « intouchée la vision productiviste de la classe », et identifie les ouvriers avec leur vocation.
2) Seidman est le seul à avoir mis en évidence le fait que beaucoup d’ouvriers ne se sont pas investis à fond dans la production à Barcelone après le 19 juillet 1936. Il estime que les individus et des groupes résistèrent comme ils purent – le plus souvent « en creux » – aux contraintes énormes et absurdes engendrées par la guerre et par le travail moderne. À partir des sources syndicales et patronales, il a recensé les façons multiples d’échapper au salariat à Barcelone : « L’absentéisme, les fausses maladies, les retards et les grèves constituaient une résistance directe. […] La résistance indirecte consistait en vol, sabotage, coulages de cadences, indiscipline et indifférence. […] À Barcelone, la désobéissance persistante impliquait un désaveu implicite de la direction économique par les syndicats. […] Tout cela limitait le rendement et provoqua les réactions coercitives des appareils syndicaux. »
Cette désaffection au travail participait aussi sans nul doute de la démoralisation qui se généralisa au front comme à l’arrière quand il fut évident que le projet révolutionnaire était enterré en Catalogne, notamment après mai 1937.
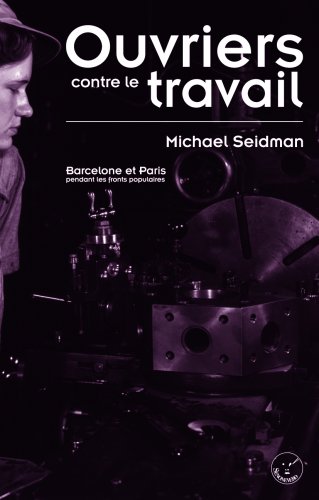
3) Seidman conclut que : « Les théoriciens anarcho-syndicalistes n’ont jamais réfléchi en profondeur à l’éventuel conflit entre la forme démocratique des conseils et le contenu du programme de rationalisation économique et d’industrialisation. […]. Confrontés au choix entre la participation des ouvriers à la production et à son efficacité, certains libertaires en vinrent à justifier de punir celui qui, « en raison de sa mauvaise volonté ou d’un autre motif, ne voudrait pas céder à la discipline consensuelle. […] Les théoriciens de la modernisation supposent des ouvriers qui s’accordent à la cadence, à la structure et aux nécessités du travail et du lieu de travail. Les marxistes, les anarchistes et les anarcho-syndicalistes perçoivent la classe ouvrière comme désireuse d’exproprier un jour les moyens de production. Les principaux courants du marxisme et de l’anarchisme poussent la soumission au travail à une conclusion extrême, même si logique, et proposent la construction d’une utopie sur le lieu de travail. Malgré leurs différences, la théorie de la modernisation et le marxisme (y compris ses variantes anarchistes) ont une vision comparable de la soumission ouvrière au travail. En effet, on peut dire que la théorie de la modernisation a simplement prolongé le consensus sur le travail dont était largement absente toute critique, que les marxistes et les anarchistes ont mis en place au XIXe siècle. »
Ce que nous relions à ce propos de M. Postone, in Temps, travail et domination sociale, 2009 [7] : « La position traditionnelle [des marxistes] donne de la dignité au travail fragmenté et aliéné. Il est fort possible qu’une telle dignité ait été un élément important pour l’estime de soi des travailleurs et qu’elle ait constitué un puissant facteur de démocratisation et d’humanisation des sociétés capitalistes industrialisées. Mais l’ironie de cette position c’est qu’elle pose implicitement la perpétuation d’un tel travail et de la forme de croissance qui lui est liée comme nécessaires à l’existence humaine. »
Tout cela donne encore à réfléchir aujourd’hui. Comme l’écrit Bruno Astarian, il faudrait qu’une prochaine insurrection « ne se réapproprie jamais les éléments de la propriété capitaliste pour reprendre la production à son propre compte. […] [Ce qui annoncerait] la possibilité d’un rapport des individus entre eux qui n’ait pas le travail pour contenu [8] » (In Activité de crise et communisation, 2010).
Publier aux éditions Divergences a-t-il un sens historique, idéologique, économique ?
Divergences est une jeune maison d’édition indépendante qui publie des ouvrages de critique sociale et politique. Lancée dans la foulée des manifestations de mai 2016, elle oriente ses publications vers une critique radicale du travail et du capitalisme en général, ce qui nous semble essentiel. Elle s’attache à publier des ouvrages exigeants tout en essayant de les rendre assez largement accessibles en les diffusant en librairie ou dans des lieux de lutte, et en essayant de pratiquer des prix bas :
- Si le « papier » peut paraître être un choix risqué aujourd’hui, nous sommes convaincus de la nécessité de continuer à produire des livres, des livres de papier, d’encre et de colle. Des livres qui s’usent, qui se prêtent, qui se déchirent, qui circulent, des livres qui vivent et qui interpellent.
- Si le livre est bien une marchandise, il se doit de dépasser cette pauvre condition de base pour « risquer […] le court-circuit d’une rencontre, tenter un contact qui ne soit pas une médiation marchande, une reconnaissance qui soit stratégique et non spectatrice. » (La Cassure, 2017)
- Chaque livre que l’on publie répond à un désir ou à une nécessité : saisir un peu mieux tel aspect de notre société, intervenir dans une situation politique concrète, éclairer tel aspect de notre histoire.
Divergences conjugue ses efforts avec l’animateur de l’émission « Sortir du capitalisme », diffusée sur Radio Libertaire, pour faire circuler un discours critique sur ce monde et aider à la compréhension de son fonctionnement.
Les Giménologues y sont d’ailleurs intervenus à plusieurs reprises sur le communisme libertaire et la révolution espagnole.
[1] Les fils de la nuit. Souvenirs de la guerre d’Espagne (juillet 1936 – février 1939) suivi de À la recherche des fils de la nuit par les giménologues. Troisième édition entièrement revue, corrigée et augmentée (avec le dvd du feuilleton), Libertalia, Paris, 2016 (voir en ligne). Une édition espagnole a été publiée en 2009, et une américaine est prévue pour 2018.
[2] Il n’y a désormais plus de protagonistes vivants, mais certains de leurs enfants ont bien des choses à raconter.
[3] telles qu’elles avaient été forgées au sein de l’Internationale anti-autoritaire en 1880, après abandon des principes collectivistes, et aussitôt adoptées dans presque toutes les sections de l’AIT.
[5] Source : Collectif, 1997, Le Congrès anarchiste International d’Amsterdam (1907), introduction d’Ariane Miéville et Maurizio Antonioli, Nautilus&Editions du Monde Libertaire, Rennes/ Paris, 1997
[6] In Paniagua, 1982 : La sociedad libertaria : agrarismo e industrialización en el anarquismo español (1930-1939)
[8] « Aujourd’hui, l’interdépendance des deux classes est plus étroite que jamais. Ce qui est une autre façon de dire que le prolétariat ne peut pas sauver les emplois que le capital menace sans sauver le capital lui-même, c’est-à-dire travailler plus dur pour moins de salaire. La qualification du travail étant partie d’entre les mains du travailleur pour s’incorporer dans le capital fixe, le prolétariat ne peut plus soutenir, comme dans la domination formelle, qu’il pourrait simplement s’approprier les moyens de production et produire sans les capitalistes. Cette prétention était déjà une illusion pour les ouvriers de métiers. Aujourd’hui, même les travailleurs qualifiés savent que la plupart des conditions matérielles-techniques de leur activité sont incorporées à la machine, à l’ordinateur, au véhicule qui est leur moyen de travail. Autrement dit, la fonction de la propriété n’est plus –si elle l’a jamais été – de jouir de ses revenus, mais d’assurer la gestion d’un appareil de production et de reproduction qu’elle a développé, précisément, pour qu’il échappe complètement et définitivement au contrôle de la classe ouvrière. Même si elle éliminait tous les capitalistes toucheurs de dividendes, une révolution ouvrière qui n’envisagerait que de réapproprier les moyens de production ne pourrait échapper à en confier la gestion à une catégorie particulière de travailleurs qui deviendraient le capitaliste collectif. L’autogestion est aujourd’hui une chimère pour cadres. » Extraits de « Activité de crise et communication », de Bruno Astarian, 2010.


